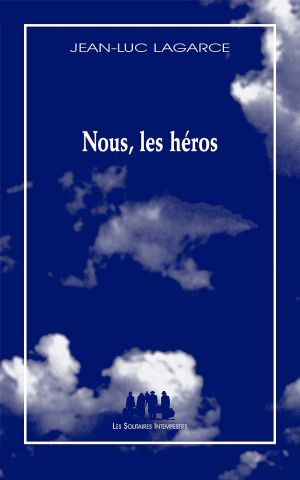
Origine du nom des personnages
Colloque de Strasbourg – Année (...) Lagarce, vol. I
de Françoise Dubor Jean-Pierre Han Françoise Heulot-Petit Geneviève Jolly Yannic Mancel Patrick Le Bœuf Georgeta Miron Julie Sermon Bruno Tackels Peter Peter Vantine Marie-Isabelle Boula de Mareuil
Présentation
Quels enjeux d’écriture, quelles inventions dramaturgiques, quel discours sur le monde le théâtre de Jean-Luc Lagarce nous invite-t-il à découvrir ? Les actes de Problématiques d’une œuvre, premier colloque d’une série de quatre, proposent les contributions d’enseignants, chercheurs, mais aussi philosophe, conservateur ou dramaturge.
Il s’agit de parcourir l’œuvre afin d’en dégager les constantes dramaturgiques, de considérer les contextes historique et théâtral qui sont les référents de l’écriture lagarcienne, ou encore de cibler l’analyse sur certaines pièces considérées isolément (en particulier Nous, les héros). En d’autres termes, de proposer des points de vue croisés et complémentaires qui dessinent une réflexion inaugurale sur l’auteur Lagarce, qui lancent des pistes, ouvrent des voies afin d’inviter à continuer d’explorer son œuvre.
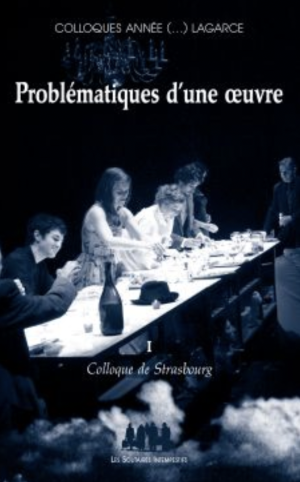
Extrait de l'article de Patrick Le Bœuf dans Problématiques d'une œuvre
Tous les noms qui apparaissent dans Nous‚ les héros‚ même de manière occasionnelle‚ proviennent de l’univers de Kafka – mais pas uniquement du Journal : romans et nouvelles de Kafka sont également sollicités par Lagarce.
Joséphine
Joséphine est le prénom de l’héroïne éponyme d’une nouvelle écrite par Kafka en mars 1924‚ et intitulée Joséphine la cantatrice ou le Peuple des souris (1). La Joséphine de la nouvelle se prend pour une artiste et est considérée comme telle par les autres souris. Il y a toutefois lieu de douter de la réalité de ses talents artistiques : elle ne sait en fait que couiner exactement comme le font toutes les autres souris. Son art ne réside que dans la seule affirmation qu’il s’agit d’un art : dire « je suis artiste » équivaut‚ chez le peuple des souris‚ à être artiste‚ et n’appelle pas d’autre justification. De même‚ la Joséphine de Nous‚ les héros n’atteint au statut de comédienne qu’en demeurant pétrifiée sur la scène‚ simple figurante que l’on pourrait remplacer par une statue :
JOSÉPHINE. – Moi ? Je ne fais rien. Je ne bouge pas‚ j’écoute‚ je ne bouge pas (...)‚ je fais ce qu’on m’a dit‚ je reste immobile‚ paralysée.
Sa mère affirme que cela suffit pour faire d’elle une actrice comique‚ mais cette affirmation ne convainc pas Monsieur et Madame Tschissik‚ pour qui l’art véritable demande plus de travail.
La description physique que Kafka donne de sa Joséphine peut fournir du matériau au metteur en scène de Nous‚ les héros et à la comédienne qui interprète Joséphine. Il ne s’agit pas de reproduire sur scène la Joséphine imaginée par Kafka‚ mais de trouver‚ par exemple dans le passage suivant‚ une source d’inspiration pour des attitudes corporelles‚ des gestes‚ de possibles manières d’être de la Joséphine de Nous‚ les héros :
Quand elle veut commencer‚ dans un effort visiblement suprême‚ lasse‚ les bras non pas déployés comme toujours‚ mais pendant sans vie le long du corps – son geste fait toujours penser qu’ils sont peut-être un peu trop courts –‚ quand elle veut commencer ainsi‚ elle s’aperçoit une fois de plus qu’elle n’y est réellement pas‚ sa tête l’indique d’un sursaut involontaire... Joséphine s’effondre à nos yeux.
Deux didascalies de Jean-Luc Lagarce font clairement écho à un passage de la nouvelle de Kafka. Ces didascalies sont exactement symétriques‚ et prennent place vers le début et vers la fin de la pièce : peu de temps après le lever de rideau‚ la pauvre Joséphine est jetée en pâture aux regards des autres personnages : « Ils la regardent tous‚ longuement et en effet‚ involontairement‚ il faut bien l’admettre‚ elle est risible. » De nouveau‚ en fin de parcours‚ elle est la cible de tous les regards : « Ils la regardent tous‚ longuement et en effet‚ il faut bien l’admettre‚ tout le monde veut pleurer aussi. » Le peuple des souris‚ lui aussi‚ entretient une relation ambiguë avec l’envie de rire que suscite Joséphine la cantatrice :
(Le peuple) ne serait pas capable‚ par exemple‚ de rire d’elle. On peut bien se l’avouer‚ il y a chez Joséphine des choses qui en donneraient envie [(..) ; mais de Joséphine‚ nous ne rions pas ; (...) la pire méchanceté que les plus méchants d’entre nous puissent se permettre à l’égard de Joséphine est de dire parfois : « Rien que de la regarder‚ cela nous coupe le rire.»
Eduardowa
Le nom d’Eduardowa apparaît dès les premières pages du Journal de Kafka‚ à l’année 1910. Il s’agit d’Evguénia Platonovna Édouardova (1882-1960)‚ danseuse russe‚ membre des Ballets russes qui étaient en tournée à Prague en 1910. Kafka rêve qu’il lui demande de danser une czárdás‚ et qu’il l’interroge sur les fleurs qu’elle porte piquées dans sa ceinture. Puis il raconte qu’elle prend toujours le tramway accompagnée de deux violonistes dont la musique agrémente aussi le trajet des autres voyageurs. Enfin‚ il constate que la ballerine est beaucoup moins belle dans la vie réelle que sur scène. On trouve donc déjà dans le Journal de Kafka les aspects oniriques et fantasques de l’Eduardowa de Nous‚ les héros‚ et son goût pour la danse vient de la profession même de son modèle.
Dans le rêve que relate Kafka‚ elle lui dit : « Je suis une méchante‚ une mauvaise femme‚ n’est-ce pas ? » À quoi Kafka répond : « Oh non‚ pas cela. » (2) Lagarce reprend cet échange de répliques‚ transposé au masculin‚ entre Max et Raban : « Tu trouves‚ toi aussi‚ que je suis un méchant homme ? – Oh‚ non‚ pas cela. »
La description physique que donne Kafka de « la danseuse Eduardowa » est pleine d’ironie :
Ce teint blême‚ ces pommettes qui tendent la joue (...)‚ ce grand nez qui surgit comme d’un creux (...). Avec cette silhouette large à la taille prise haut dans des jupes surchargées de plis – à qui cela peut-il plaire ? – elle ressemble à l’une de mes tantes‚ une dame déjà âgée‚ beaucoup de vieilles tantes de beaucoup de gens ont cet air-là. Mais à part les pieds‚ qui sont fort bien‚ (...) il n’y a vraiment rien qui puisse susciter l’admiration‚ l’étonnement ou même le respect. Et de fait‚ j’ai bien souvent vu la Eduardowa traitée avec une indifférence impossible à dissimuler (...).
À cette dernière phrase fait peut-être écho la réflexion du Max de Nous‚ les héros au sujet d’Eduardowa : « Personne ne voudra peut-être jamais d’elle et cela‚ certainement‚ qui me séduit le plus profondément... »
J’ai montré à notre metteur en scène une photographie de « la vraie » Evguénia Platonovna Édouardova en costume folklorique‚ prenant la pose devant un décor campagnard de toile peinte – sans surprise‚ il a déclaré tout net que « notre » Eduardowa ne devait en aucun cas s’en inspirer.
Il est à noter que le personnage décrit par Kafka – plutôt que l’Édouardova historique – a également inspiré deux musiciens : le Hongrois György Kurtág‚ qui a utilisé quelques phrases du texte de Kafka pour une section de ses Kafka-Fragmente op. 24 (1985- 1986)‚ et l’Écossais Martin Dalby‚ qui a composé en 1978 une oeuvre intitulée The Dancer Eduardova.
Karl
Karl est le prénom de Karl Rossmann‚ le protagoniste du roman inachevé Amerika (1912-1915).
Karl Rossmann est contraint par ses parents à émigrer en Amérique‚ en expiation d’une faute‚ alors que le Karl de Nous‚ les héros veut partir pour l’Amérique précisément pour fuir ses parents. Jean- Luc Lagarce n’indique pas l’âge précis de Karl ; dès la première ligne d’Amerika‚ Kafka nous informe que Karl Rossmann est âgé de 17 ans – information d’ailleurs contredite au chapitre V‚ où Karl Rossmann déclare : « J’aurai seize ans le mois prochain. »
Toutefois‚ lorsque Karl évoque les détails de la vie américaine telle qu’il la fantasme‚ ce n’est pas Amerika qu’il cite‚ mais bien le Journal‚ et plus précisément les propos d’un cousin de Kafka installé à Chicago : « Quinze dollars par semaine. Deux semaines de congé dont une est payée ; au bout de cinq ans‚ congé entièrement payé (3). »
Karl Rossmann éprouve du dégoût pour la sexualité. Il se laisse violer par les femmes plus qu’il ne cherche à les séduire. Le Karl de Nous‚ les héros a également une attitude ambiguë dans ce domaine‚ même si les expériences sexuelles qu’il relate‚ vers la fin de la pièce‚ proviennent‚ là encore‚ du Journal (4) et non d’Amerika. Kafka ne dit pas grand-chose de l’aspect physique de Karl Rossmann‚ sinon que les femmes le trouvent charmant (5).
Amerika a été adapté au cinéma en 1984 sous le titre Klassenverhältnisse par Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Karl Rossmann est interprété dans cette adaptation cinématographique par Christian Heinisch‚ qui donne l’image d’un grand jeune homme blond‚ au visage fermé‚ un masque délibérément inexpressif.
Raban
Raban emprunte son nom au patronyme d’Édouard Raban‚ le protagoniste de la nouvelle inachevée Préparatifs de noce à la campagne (1907-1908)‚ nouvelle dont Lagarce avait utilisé le titre‚ légèrement modifié (Préparatifs d’une noce à la campagne) pour une première adaptation théâtrale du Journal de Kafka en 1984.
Édouard Raban s’apprête à prendre le train pour aller passer deux semaines de vacances à la campagne dans la famille de sa fiancée Betty‚ qui s’y trouve déjà depuis une semaine. Cette semaine de séparation a fait naître le doute en lui quant à ses sentiments réels. A-t-il vraiment envie d’aller la rejoindre ?
Si du moins je me trompais de train‚ pensait Raban. J’aurais vraiment l’impression d’être engagé dans mon entreprise‚ et si‚ une fois mon erreur expliquée‚ je me retrouvais à cette station après avoir fait le chemin en sens inverse‚ je me sentirais déjà beaucoup mieux. (11)
Déjà toute l’indécision du Raban de Nous‚ les héros‚ son incapacité à prendre barre sur sa propre vie‚ son désir immature d’être entraîné par le destin plutôt que d’agir par lui-même pour l’infléchir dans le sens qu’il souhaiterait. Madame Tschissik lui reproche à juste titre : « Vous voudriez connaître les deux fins d’une même histoire‚ sans rien décider » p. 130. Reproche qui s’applique autant à l’Édouard Raban de Préparatifs de noce à la campagne qu’au Raban de Nous‚ les héros.
Max
Le personnage de Max emprunte son prénom à Max Brod (1884-1968)‚ l’un des plus proches amis de Kafka. C’est lui qui a publié ses oeuvres‚ à titre posthume ; il lui a également consacré une biographie.
Max Brod est très fréquemment mentionné dans le Journal de Kafka ; mais le rapport entre le Max Brod du Journal et le Max de Nous‚ les héros paraît plus lâche que celui qui existe entre les autres personnages de la pièce de Lagarce et leurs modèles. Leur seul point commun semble être le prénom.
Monsieur et Madame Tschissik
Les Tschissik étaient un couple de comédiens appartenant à une troupe de théâtre yiddish à laquelle Kafka était très lié‚ et dont le directeur s’appelait Jitzchak Löwy. Kafka éprouvait pour Mme Tschissik une fascination amoureuse‚ non exempte d’autoironie : « J’avais espéré satisfaire un peu mon amour pour elle en lui donnant mon bouquet‚ c’était complètement inutile. Cela n’est possible que par la littérature ou le coït (7). »
Kafka adopte souvent une attitude d’amoureux transi devant Mme Tschissik. En cela‚ il préfigure le Raban de Nous‚ les héros. Il écrit‚ le 19 décembre 1911 : « Quand ensuite elle se tint devant moi‚ (...) ce fut comme si je devais tenir un discours à une statue au milieu de spectateurs sans pitié. » Lorsque Raban déclare à Madame Tschissik : « Je suis devant vous et je tiens un discours à une statue au milieu de spectateurs sans pitié... »‚ Jean-Luc Lagarce s’amuse à placer dans la bouche de Madame Tschissik une réplique cinglante‚ cruelle : « La phrase est belle. C’est de qui ? » Évidemment‚ il sait‚ lui‚ qu’elle est de Kafka‚ puisqu’il la lui a empruntée‚ mais les spectateurs ne le savent pas‚ et il joue ainsi en secret à se moquer de sa source‚ tout en faisant une allusion ironique à son propre statut de « plagiaire » assumé (8).
Le Journal de Kafka regorge de notations sur l’aspect physique et l’attitude corporelle de Mme Tschissik‚ notations qui peuvent éventuellement apporter un soutien au metteur en scène de Nous‚ les héros :
Mme Tschissik a les joues qui saillent au voisinage de la bouche. (...) Dans le rôle de Sulamith‚ ses cheveux étaient le plus souvent dénoués et lui cachaient les joues‚ de sorte que son visage‚ parfois‚ ressemblait à celui d’une jeune fille de jadis. Son corps est grand‚ osseux‚ de corpulence moyenne‚ elle est fortement serrée dans un corset. Sa démarche prend facilement quelque chose de solennel‚ car elle a l’habitude de lever‚ d’étendre et de remuer lentement ses longs bras. (...) Mme Tschissik (j’aime tant écrire son nom) penche volontiers la tête à table‚ même quand elle mange du rôti d’oie. (9)
Anna et Émile
Les prénoms du Père et de la Mère (Émile‚ Anna) ne sont révélés par Lagarce que dans l’ultime scène de Nous‚ les héros – avec pour conséquence que les spectateurs ne pénètrent réellement dans l’intimité de ces deux personnages qu’au moment où le rideau va définitivement retomber. Dans la version sans le père‚ le prénom Émile disparaît complètement‚ et le prénom Anna devient celui de Mademoiselle. La Mère demeure innommée à tout jamais. Ce sont encore des raisons qui me font préférer la version avec le père à la version sans le père.
Dans son Journal‚ Kafka ne consignait pas que des événements réels de son existence quotidienne. Il y intégrait aussi de courts récits‚ des esquisses littéraires‚ en guise d’exercices d’écriture‚ fulgurantes fictions fragmentaires isolées de tout contexte et par là même totalement inintelligibles‚ situations romanesques juste ébauchées et dépourvues de tout développement. Lagarce a fait feu aussi de ce bois-là‚ et l’ultime scène de Nous‚ les héros est dérivée d’un dialogue noté par Kafka le 20 novembre 1911. Les changements qu’il y a apportés ne sont toutefois pas anodins ; voici les deux textes en parallèle :
Journal de Kafka :
E. – Anna !
A.‚ levant les yeux. – Oui.
E. – Viens ici.
A.‚ grands pas calmes. – Que veux-tu ?
E. – Je voulais te dire que depuis quelque temps‚ je suis mécontent de toi.
A. – Mais...
E. – C’est ainsi.
A. – Dans ce cas‚ donne-moi mon congé‚ Émile.
E. – Si vite ? Et tu ne m’en demandes pas la raison ?
A. – Je la connais.
E. – Tiens !
A. – La nourriture n’est pas de ton goût.
E.‚ se lève rapidement et très haut. – Sais-tu que Kurt part ce soir‚ oui ou non ?
A.‚ sans se troubler. – Mais oui‚ malheureusement‚ il part‚ ce n’est pas une raison pour m’avoir appelée.
Nous‚ les héros :
LE PÈRE. – Anna !
LA MÈRE. – Oui ?
LE PÈRE. – Viens ici.
LA MÈRE. – Que veux-tu ?
LE PÈRE. – Je voulais te dire que depuis quelque temps‚ je suis mécontent de toi...
LA MÈRE. – Bien.
LE PÈRE. – C’est ainsi.
LA MÈRE. – Dans ce cas‚ donne-moi mon congé‚ Émile.
LE PÈRE. – Si vite ? Tu ne m’en demandes pas la raison ?
LA MÈRE. – Je la connais‚ je l’imagine.
LE PÈRE. – Oui ?
LA MÈRE. – La nourriture n’est pas à ton goût.
LE PÈRE. – Sais-tu que Karl partira dans la nuit‚ comme un voleur‚ sans même dire au revoir ?
LA MÈRE. – Oui‚ je le sais‚ malheureusement. J’espère qu’il nous volera un peu d’argent. Je ne peux rien faire et toi non plus. Ce n’est pas une raison pour me renvoyer.
Dans le Journal‚ ce bout de dialogue est complètement suspendu en l’air. Qui sont Anna et Émile ? Quels sont les rapports qui existent entre eux ? Qui est Kurt‚ et quels rapports entretient-il avec les deux autres personnages ? Kafka ne fournit aucune explication. Lagarce intègre ce fragment à sa pièce d’une manière qui fait totalement sens‚ et cette scène apporte une superbe conclusion à Nous‚ les héros. En même temps‚ il pratique une modification de taille dans le texte de Kafka : le « ce n’est pas une raison pour m’avoir appelée » d’Anna devient : « Ce n’est pas une raison pour me renvoyer. »
Dans la version avec le père‚ ce renvoi signifierait un divorce‚ la dislocation de la famille‚ peut-être la fin de la troupe elle-même. Dans la version sans le père‚ où la même phrase est prononcée par Mademoiselle‚ elle a aussi moins de force‚ puisqu’il serait tout à fait plausible que Mademoiselle soit renvoyée‚ sans que l’existence même de la troupe soit compromise.
Le personnage du Père semble d’ailleurs cumuler sur sa seule tête des traits qui proviennent d’une part du propre père de Kafka tel qu’il est dépeint dans le Journal‚ et d’autre part de Jitzchak Löwy‚ le directeur de la troupe de théâtre yiddish où travaillaient M. et Mme Tschissik. Lagarce semble ainsi avoir fait du Père de Nous‚ les héros une sorte de synthèse de ces deux personnages réels – synthèse de la sphère familiale et de la sphère théâtrale‚ motif obsessionnel de nombre de pièces de Jean-Luc Lagarce. Et en même temps‚ ironie suprême‚ puisque le père de Kafka n’avait que mépris pour Löwy‚ et qu’il reprochait rudement à son fils de le fréquenter. Le 3 novembre 1911‚ Franz Kafka relate en ces termes une dispute qu’il avait eue avec son père à ce sujet :
Löwy : Mon père parlant de lui : « Qui couche avec les chiens attrape des puces. » Je n’ai pas pu me contenir et j’ai dit des paroles qui échappaient à mon contrôle. Là-dessus‚ mon père‚ particulièrement calme (à vrai dire au bout d’un long silence rempli par d’autres sentiments) : « Tu sais que les émotions me sont interdites et que je dois être ménagé. Et tu viens me parler sur ce ton. J’ai vraiment assez d’émotions comme cela‚ largement assez. Je te conseille donc de m’épargner de pareils propos. » Je dis : « Je m’efforce de me contenir »‚ et je sens chez mon père‚ comme toujours à ces moments de crise‚ l’existence d’une sagesse dont je ne puis saisir qu’un souffle.
Lagarce a réutilisé cet échange dans une scène de Nous‚ les héros :
LE PÈRE. – Tu viens me parler sur ce ton !
Tu sais que les émotions me sont interdites et que je dois être ménagé ! J’ai vraiment assez de soucis comme cela‚ largement assez...
Je te conseille donc de m’épargner de pareils propos...
KARL. – Je m’efforce de me contenir...
Au total‚ on constate donc que les personnages de Nous‚ les héros‚ à l’exception de Max – et‚ bien sûr‚ de ceux à qui Lagarce n’affecte pas de nom propre (le Grand-Père‚ Mademoiselle) – empruntent non seulement le nom‚ mais aussi des caractéristiques des personnages créés ou décrits par Kafka. À cela s’ajoute le fait que tous les personnages de Nous‚ les héros empruntent leur « emploi » aux personnages du Malade imaginaire‚ à l’exception de celui de Mademoiselle‚ pour qui je ne trouve de modèle précis ni chez Molière ni chez Kafka.
Notes
1. F. Kafka‚ Joséphine la cantatrice ou le Peuple des souris‚ dans La Colonie pénitentiaire et autres récits‚ traduction d’A. Vialatte‚ Gallimard‚ Paris‚ 1948.
2. Toutes les citations du Journal de Kafka sont tirées de la traduction de Marthe Robert‚ Grasset‚ Paris‚ 1954.
3. Entrée du 9 décembre 1914.
4. Entrée du 6 juillet 1916.
5. « Où est-ce que tu as donc pêché ce joli garçon ? cria-t-elle encore. » (F. Kafka‚ Amerika ou le Disparu‚ trad. de B. Lortholary‚ Garnier Flammarion‚ 1988‚ p. 26)
6. F. Kafka‚ Préparatifs de noce à la campagne‚ trad. de M. Robert‚ Gallimard‚ 1957‚ p. 23.
7. Fin de l’entrée du 5 novembre 1911.
8. Ailleurs encore‚ Lagarce exploite la même stratégie‚ lorsqu’il fait dire au Grand- Père : « Je ne comprends pas tout mais c’est bien dit »‚ juste après une citation littérale du Journal.
9. Entrées du 21 et du 22 octobre 1911.
10. Ces trois notations proviennent de l’entrée du 1er novembre 1911.
11. Ailleurs dans la pièce‚ Lagarce transforme une « Suissesse » du Journal en « chanteuse polonaise »‚ uniquement‚ semble-t-il‚ pour des raisons d’euphonie.
Patrick Lebœuf, 18 octobre 2006







