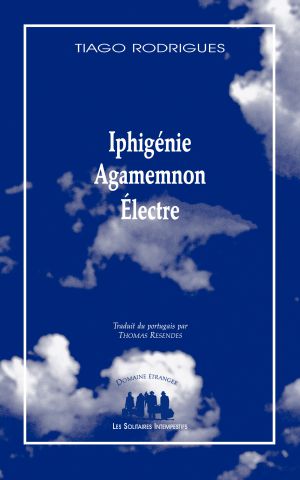

Iphigénie
Depuis l’Antiquité, la malédiction qui frappe la famille des Atrides hante le théâtre occidental. Racine comme Euripide se sont penchés sur Agamemnon, ce père qui, pour convoquer les vents nécessaires afin de rallier Troie et gagner la guerre, fait avancer sa fille, Iphigénie vers la mort. Mais c’était sans compter sur Tiago Rodrigues qui n’aime rien moins que tordre les chefs-d’œuvre du répertoire pour en filtrer une dimension inconnue. Dans cette interprétation du mythe, le dramaturge lisboète se demande quelle pourrait être la destinée de la dernière-née de la lignée si les hommes – qui décident de son sort –n’étaient pas soumis à l’autorité des dieux ? Une approche de la jouissance du libre-arbitre qui a immédiatement séduit Anne Théron dont le travail explore souvent le cri intérieur des femmes qu’elle convoque dans d’exceptionnelles mises en scène faites de sensations aussi sonores que visuelles, plastiques que théâtrales. « Clytemnestre est un personnage gigantesque. Elle demande aux hommes de renoncer. (…) C’est une femme en colère fermement décidée à ce qu’Agamemnon soit responsable de son crime face à l’histoire. En ce sens, elle fabrique ainsi une autre mémoire de la tragédie pour nous qui la regardons aujourd’hui. C’est vertigineux ! »
Qu’il combine histoires vraies et fictions, qu’il revisite des classiques ou adapte des romans, Tiago Rodrigues est profondément marqué par la notion d’écriture faite avec et pour les acteurs. Tiago Rodrigues est l’auteur entre autre
Note d'intention
Le tragique de la tragédie
Iphigénie est une tragédie parce que c’est une tragédie. Pure tautologie peut-être, néanmoins le Chœur nous prévient immédiatement : une tragédie finit toujours mal, il est impossible d’échapper au tragique de la tragédie qui se déroule à la façon d’un ostinato et reprend un motif musical récurrent. Quelles que soient ses variations, il s’agit toujours de la même partition. Qu’importe les ressorts dramatiques, une tragédie avance inexorablement jusqu’à sa conclusion fatale. Agamemnon, Ménélas, Le Vieillard, Ulysse, Achille, Clytemnestre, Iphigénie et le Chœur : ils sont tous là. Dans un autre espace/temps. Comme chez Euripide ou Racine, Agamemnon est traversé des mêmes doutes : et s’il refusait le meurtre de sa fille ? S’il renonçait à cette guerre, s’il abandonnait Hélène aux Troyens, Hélène qui a peut-être été consentante à son enlèvement ? Mais peut-on changer le cours de l’histoire, échapper à son passé, ainsi qu’à sa répétition? Pourtant, dans cette nouvelle Iphigénie, la question se déplace. Lors de son échange houleux avec son frère Ménélas, Agamemnon déclare que « Les dieux sont des histoires qu’on raconte aux Grecs pour justifier ce qu’ils ne comprendraient pas autrement. » Clytemnestre renchérira plus tard : « Les dieux sont une fable qu’on nous raconte pour nous souvenir autrement de ce qui s’est réellement passé. ». Un postulat qui signifie que les dieux n’existent pas. Les hommes se retrouvent soudain seuls face à leur libre-arbitre et les Figures de la tragédie antique, libérées du joug de puissances supérieures, s’incarnent tout à coup sous la forme de personnages, aux prises avec leur propre être.
Néanmoins, paradoxe de la pièce de Tiago Rodrigues, Ménélas répond à Agamemnon : « La fin restera la même quelle que soit ton action». Effectivement, en apparence, la tragédie s’achèvera de la même façon mais, malgré cette fin inéluctable, elle sera foncièrement nouvelle en ce sens qu’elle sera déterminée par la volonté des personnages. Iphigénie ne meurt plus cette fois-ci par obéissance aveugle à son père, soumission aux dieux, ou par humilité face à la cause des soldats grecs. Elle ne subit plus sa destinée, elle la choisit et interdit à la mémoire collective de s’emparer de cette mort qui lui appartient, à elle seule : « Terminé les souvenirs. Je ne veux plus de vos souvenirs. Je meurs. Mais c’est moi qui meurs. Et pas parce que quelqu’un s’en souvient. Je meurs parce que, oui, je choisis de mourir. Je n’appartiens pas à vos souvenirs. J’appartiens à moi seule. Je meurs pour être oubliée. Ma mort est à moi. »
En refusant les codes d’une écriture qui, jusqu’à présent, ignorait et censurait la parole de l’intime, cette Iphigénie permet de dire autrement, de raconter autrement. Si elle ne dévie pas le cours de l’histoire, elle la déplace au centre des relations humaines. LA LANGUE DE L’AUTEUR RACONTE UNE TRAGÉDIE MAIS ÉCHAPPE AU TRAGIQUE.
Mémoire singulière contre mémoire collective
Apparaît un nouveau paradigme où les personnages émergent à eux-mêmes. Ensemble, ils revisitent le cauchemar, l’impensable, l’assassinat collectif d’une jeune femme par ordre d’une instance supérieure. Cette langue nouvelle, échappant aux croyances et aux vertus qui enfermaient les protagonistes dans leur rôle de Figures, les conduit à une catharsis libératoire qui leur permet enfin de s’exprimer en leur nom, d’incarner les situations au lieu de s’y soumettre, parce que la pièce introduit un autre rythme : celui du questionnement intérieur
En invoquant leur propre mémoire en opposition à cette mémoire collective qui émerge du fond des temps, les personnages se découvrent tout à coup sujets. «Qui parle quand je parle ? » semble être la question sous-jacente au « Je me souviens…» récurrent qui introduit le possible d’une pure singularité. Chacun s’appuie sur ses propres souvenirs, à la recherche de lui-même, dans une tentative commune d’échapper à la fiction de la tragédie. En contestant leurs rôles, ils deviennent autres, face au vertige de leur liberté.
Iphigénie et Clytemnestre : deux femmes libres
Si Agamemnon, Ménélas et Achille questionnent l’histoire, ils plieront finalement devant le diktat de la tragédie. Pourtant, Agamemnon sait pertinemment ce qu’il adviendra, il le dit à Ménélas : « (…) je me suis souvenu du futur. ». Il connaît le nombre de morts, à commencer par lui-même, qui sera déclenché par le sacrifice d’Iphigénie. « C’est inévitable » finira-t-il par admettre. Au nom des Grecs dont il est le roi, il ne peut refuser la guerre. Pour qu’il y ait la guerre, il faut que le vent souffle. Et pour que le vent souffle, Iphigénie doit mourir. Agamemnon ne croit pas aux dieux mais il croit au pouvoir. Tous les hommes de la pièce croient au pouvoir qui, selon eux, implique la guerre. Et donc la mort de l’innocence qu’Iphigénie représente.
Clytemnestre, elle, est en colère. Elle ne croit pas aux dieux et propose également d’oublier la guerre et le pouvoir. En clair, elle propose de recommencer à zéro, dans un autre rapport au monde. Sinon, Agamemnon sera responsable en son nom des conséquences de son crime. Cela fabriquera une autre mémoire, celle concernant des hommes coupables d’exactions, pour lesquelles ils devront rendre des comptes. Un homme libre est responsable de ses actes. Elle-même revendique par avance le meurtre d’Agamemnon pour le sacrifice de sa fille. C’est en femme libre qu’elle exécutera la vengeance, prévient-elle. Agamemnon lui répond que la décision de refuser la guerre ne lui appartient pas, qu’il ne peut pas faire ce qu’il veut. Asservi à une idée du pouvoir, il n’a pas la force de s’en affranchir.
Iphigénie aussi est en colère. Mais elle ne réclame aucune vengeance. Elle veut échapper au mensonge, que ce soit à celui des dieux ou à celui des hommes, et se refuse à perpétuer le perpétré, c’est à dire à collaborer avec un système où le pouvoir engendre le crime.
La mort d’Iphigénie clôture cette réappropriation par le sujet de sa propre destinée. C’est elle qui tranche de façon radicale le lien qui l’attachait à la tragédie et qui permet à tous de ne plus être soumis à la répétition du tragique. Elle meurt en femme libre, définitivement solitaire quant à cette décision : «Ne me touchez pas. Ni maintenant, ni après. Ce corps est le mien. Plus rien, ni personne ne peut me toucher. Je suis déjà morte. On m’a déjà oubliée. Ne racontez plus jamais mon histoire. Adieu. »
L’attente
L’ATTENTE, que partagent tous les personnages, est un temps mort qui, paradoxalement, crée de L’URGENCE, dans une densité croissante de l’atmosphère et des corps. Il faut imaginer des armées à l’arrêt, des hommes désœuvrés dans un temps dilaté, face à l’infini de la mer. Que font-ils ? Jouent-ils aux cartes, laissent-ils filer le sable entre leurs doigts, réclament-ils régulièrement le silence pour écouter le vent qui les arrachera à cette immobilité contrainte ? Comment décrire cette incroyable nostalgie qui les saisit quand ils songent à ceux qu’ils ne reverront peut-être plus car rien n’est pire que cette atonie qui les conduit à la tristesse, sinon à la dépression. Ou à la rage. Ils meurent d’en découdre, ils ont été convoqués pour se battre et tuer. Une rage qui les plonge dans une tension qui fige plus encore l’air autour d’eux. Ou alors, ils rêvent de l’avenir, quand ils rentreront couverts de sang et d’or.
L’OBJET THÉÂTRAL
Le plateau serait une partie retirée de la plage immense où tous attendent que le vent se lève. La mer gîte au loin, derrière une digue, sur un écran où sont projetées les silhouettes fantomatiques des soldats, accroupis, installés autour d’un feu, désœuvrés, ou debout, immobiles face au large, scrutant l’horizon, ou encore arpentant le rivage. On les aperçoit filmés de dos, ressemblant à de petites taches floues, se mouvant au ralenti. La mer peut prendre toute l’image, effacer les soldats en attente. Il ne reste plus que cette immensité d’eau, faussement calme.
Ce n’est plus la Méditerranée mais la mer du Nord, que les marées éloignent puis rapprochent, dans un mouvement incessant. Que le vent disparaisse pendant des jours et des jours est difficilement concevable. C’est cette impression que donne le film : une absence angoissante. Et pourtant, le vent est là. Que les soldats ne le perçoivent pas est étrange. Est-ce parce qu’ils aimeraient entendre le déchaînement de la tempête, les hurlements des soldats à l’assaut, les supplications des blessés ?
Le son raconte ce qu’on ne voie pas, les bruits de ces armées navales invisibles à l’écran, les bateaux à l’arrêt, le très vague clapotis d’une vague sur la coque d’un bateau dans un gros plan sonore. Quand il s’interrompt, on entend le silence comme si l’on s’était suffisamment éloigné. Ou cette chanson qu’Achille fredonne pour Iphigénie.
Parfois des craquements brutaux secouent le plateau qui se disloque. Comme si des plaques tectoniques s’écartaient brutalement, sous la poussée d’une force invisible. Plusieurs fois, cela se répète, des îlots s’éloignent les uns des autres.
Le sol a beau se disjoindre, les comédiens sont là, ils se souviennent et refusent que le texte se répète. Bien que le Chœur les prévienne, une tragédie finit toujours mal, ils tenteront jusqu’au bout de lutter contre la destinée.
Parce que tous ne se souviennent pas d’exactement la même chose, la tragédie devient comique. À force de chercher ensemble, quelques-uns en devancent d’autres qui se cabrent, certains contestent, convoquant Racine ou Euripide. Salle de répétitions dans un décor, fiction bringuebalante à cause des trous de mémoire ou réalité en train de se constituer sous nos yeux. Quoi qu’il en soit, l’Iphigénie de Tiago Rodrigues refuse le tragique. D’ailleurs, elle ne meurt pas, elle échappe à un monde où tout est mensonge et interdit à quiconque de se souvenir d’elle. Iphigénie est une jeune femme libre. Elle efface la mémoire de la sujétion, et du meurtre sacrificiel. Elle ne baisse pas la tête, ni les yeux. Elle regarde droit devant, elle sourit.
Anne Théron
Note d'intention issue du dossier de production (Productions Merlin)
Critiques
 Téléramapar Fabienne Pascaud
Téléramapar Fabienne PascaudL’Iphigénie de Tiago Rodrigues, belle héroïne féministe dans une mise en scène maniérée
Revisité par le Portugais Tiago Rodrigues et mis en scène par Anne Théron, le texte d’Euripide se fait moderne et engagé. Un parti pris fort. Dommage que le spectacle, que France 5 diffuse ce vendredi soir, souffre d’effets scénographiques artificiels...
 Scenewebpar Vincent Bouquet
Scenewebpar Vincent BouquetIphigénie au défi du genre humain
Immergés dans ce clair-obscur qu’affectionnent les purgatoires, ils surgissent tels des fantômes recrachés par les flots mémoriaux. Leurs contours sont aussi flous que leur démarche est hésitante, et leur identité incertaine. Convoquées par un murmure qui ne tarde pas à se transformer en brouhaha, ces figures spectrales reprennent peu à peu forme humaine pour donner à voir leurs vrais visages, ceux d’Agamemnon, Clytemnestre, Iphigénie et consorts...
 Le Mondepar Brigitte Salino
Le Mondepar Brigitte SalinoThéâtre : « Iphigénie » sacrifiée sur l’autel de la disgrâce
Le mistral souffle, ce 7 juillet, à Avignon. Mais c’est un autre vent qui affole les corps et les esprits en ce jour d’ouverture du festival : le vent que l’on attend et qui ne vient pas. Le vent d’Iphigénie. Pas celle d’Euripide ni de Racine ; celle de Tiago Rodrigues – le successeur d’Olivier Py à la tête du festival...
(abonnés)
Archives des représentations
-
L'Onde Théâtre Centre d'Art
|
Vélizy-Villacoublay
25 avr. > 26 avr. 2024
-
Théâtre du Beauvaisis
|
Beauvais
05 déc. > 07 déc. 2023
-
Le Grand R
|
La Roche-sur-Yon
08 févr. > 09 févr. 2023
-
Teatro Nacional São João
|
Porto
27 janv. > 28 janv. 2023
-
Célestins, Théâtre de Lyon
|
Lyon
18 janv. > 22 janv. 2023
-
L'Empreinte - Scène nationale Brive-Tulle
|
Brive
01 déc. > 02 déc. 2022
-
Scène Nationale du Sud-Aquitain
|
Bayonne
22 nov. > 23 nov. 2022
-
Théâtre National de Strasbourg - TNS
|
Strasbourg
13 oct. > 22 oct. 2022
-
Festival d'Avignon
|
Avignon
07 juil. > 13 juil. 2022
-
Scène Nationale d'Albi
|
Albi
10 oct. 2023
-
La Maison
|
Nevers
30 avr. 2024
-
Les Salins
|
Martigues
08 nov. 2022
-
Anthéa - Antipolis
|
Antibes
06 avr. 2024
-
Théâtre de Perpignan
|
Perpignan
13 oct. 2023
-
Le Moulin du Roc
|
Niort
17 nov. 2022
-
Théâtre du Passage
|
Neuchâtel
27 oct. 2022







