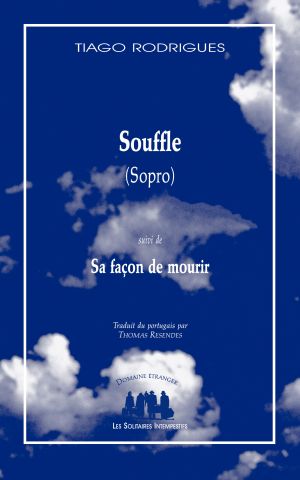
Entretien pour le Festival D'Avignon
Vos spectacles se situent souvent dans ce que vous appelez le «no man’s land où ont lieu les négociations du théâtre». Qu’apporte le dévoilement de ces négociations?
Tiago Rodrigues: L’idée d’illusion est légitime au théâtre. En tant que spectateur, elle peut m’amuser. En tant qu’artiste, je n’ai rien à voir avec elle. L’illusion n’est pas mon champ de bataille. Il y a des formes comme des discours politiques ou esthétiques opaques, ils imposent, disciplinent les corps, les voix, pour les transformer. C’est un mouvement, une projection déterminés à l’avance. Face à cela, je préfère l’endroit où le texte, le jeu théâtral et la mise en scène servent à créer de la transparence et à mettre en débat des propositions de plusieurs humanités. Il est très important pour moi d’inventer un code, une forme mais cette construction se fait peu à peu et ensemble. Les premières minutes de mes spectacles reproduisent les problèmes des premiers jours de répétitions. Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce qu’on vise? Il faut inviter les gens dans la grammaire; ne pas présenter un vocabulaire que nous aurions créé entre nous et décider d’y vivre arbitrairement, mais offrir une introduction à cette langue et se rappeler en tant qu’artiste, sur scène, chaque soir, le pourquoi, le point de départ, d’où ça vient, où suis «je» dans ce monde-là.
Pour Souffle, de quoi disposiez-vous au début des répétitions?
Le premier jour de répétition de Souffle, j’avais trois, quatre petits textes que j’avais écrits la veille. Ce n’était pas le texte du spectacle. C’était une matière pour se poser des questions et j’interrogeais les acteurs via ces petits textes. Au fur et à mesure, nous avions de plus en plus de matière, donc de plus en plus de questions, et à un moment, alors que nous nous posions une nouvelle question, nous nous sommes dit: «Ce n’est plus une question, c’est quelque chose à montrer. On peut le sélectionner.» Dans mon processus de travail, je commence toujours par le vide. «Je vais créer un spectacle, autour de la souffleuse, il y aura Cristina sur scène (parce que la première chose que j’ai faite, c’est séduire Cristina et la convaincre d’être sur scène, à vue, pour la première fois de sa vie) et je pense qu’on a là une opportunité. Elle est là, alors qu’est-ce qu’on fait avec elle?» Voilà ce que je dis à l’équipe. La seule chose que je sais – et qui est incroyable, il ne faut jamais l’oublier –, c’est que j’ai l’argent pour le faire et l’espace pour le répéter – ce qui a changé ma vie quand je suis entré au Théâtre national. Sinon, je n’ai qu’une petite idée et – mais c’est beaucoup – des personnes qui ont envie d’essayer avec moi.
La «petite idée» n’était-elle pas grande pour avoir envie de vous lancer?
Oui, au moment où je la propose à une équipe, je peux déjà en parler assez longtemps avec honnêteté. C’est une petite idée parce qu’elle n’est pas développée mais ce n’est pas qu’une petite idée puisqu’elle ouvre déjà de grandes voies : la question de la respiration, des poumons, de la conscience du théâtre, du souffleur comme centre névralgique, nerveux, émotionnel et presque moral d’un bâtiment théâtral. La fonction du souffleur comporte plusieurs couches qui se trouvent dans d’autres métiers. Le régisseur général, par exemple, a aussi cette fonction de mémoire, de discipline, de méthode, de protection. Mais on peut voler ces caractéristiques et les condenser dans le souffleur parce qu’il contient l’humilité passionnée des coulisses, tout en comprenant intimement la fonction de comédien. Il est en eux – un peu comme la main du marionnettiste dans la poupée de chiffon. La figure du souffleur concentre non seulement l’histoire du bâtiment théâtral mais aussi l’essence du geste théâtral parce qu’elle est avant l’esthétique, avant la forme; son travail est souterrain. Elle assure la mémoire du sens radical des mots originels et la protection d’un avant-sens du texte. Après on prend plusieurs chemins mais là sont vraiment les poumons ; ce n’est même pas le cœur, ce sont les poumons dans le sens que le souffleur exhale l’essence du théâtre.
Pourquoi en venir aujourd’hui à cet essentiel?
J’avais déjà cette idée et j’avais discuté avec Cristina Vidal qui est souffleuse, en travaillant au Teatro Nacional Dona Maria II comme invité en 2010. Faute d’argent, l’idée était restée idée. Puis quand je suis arrivé à la direction, j’ai de nouveau travaillé avec des souffleurs et je me suis dit: c’est au moment où j’ai le plus de moyens que je dois parler de ce qui se passerait si je n’en avais aucun. Pas seulement moi, mais le théâtre. Dans un temps où, partout en Europe, la possibilité d’un théâtre à grande échelle, d’un théâtre de compagnie ou de répertoire s’éteint parce que la légitimité des soutiens à la création est en danger, ce spectacle pose la question: «Que se passe-t-il si ce que nous avons maintenant – qui devrait être plus, mais qui est beaucoup en comparaison avec tous les autres artistes – disparaît?» C’est aussi une promesse de continuation. Si le Théâtre national ferme demain, nous pourrons jouer cette pièce dehors. Une des forces des artistes est de dire: malgré les circonstances économiques, politiques, sociales: même si à présent la société accepte une violence contre la création, «nous serons là» – pas nécessairement nous, mais des gens comme nous – dans cent ans. Fermer tous les théâtres ne fermera pas le théâtre. Il y a dans ces bâtiments, ces associations, ces compagnies des poumons qui fonctionnent sans vous, et qui fonctionneraient même dans des ruines. Si tout ferme, on continue à faire du théâtre; ça, c’est sûr. Ce sera clandestin, secret mais ça aura lieu. On le sait. La question à poser à la société est: quel accès voulez-vous avoir à cet art? Voulez-vous en tirer les bénéfices et les proposer aux membres de votre société tandis que ça a lieu? Parce que ça a lieu. Un pouvoir s’exerce dans le simple fait que ça ait lieu. Une chose essentielle reste quand tout part, et pour moi la souffleuse en est une bonne métaphore parce que c’est une profession qui a presque disparu mais aussi parce que c’est un métier plus qu’une vocation. Plus que le comédien, la souffleuse est la figure morale, émotionnelle du théâtre qui donne une idée de sa survie au-delà même du comédien, au-delà de ce qu’on voit du théâtre.
Les ruines du théâtre où se passe ce spectacle sont-elles donc plus une projection qu’un passé à reconstruire?
Oui, même si pour présenter notre projet nous avons utilisé des images d’archives de l’incendie du Théâtre national en 1964, ce sont plutôt les ruines du Théâtre national en 2080 qui m’intéressent. Je regarde beaucoup les œuvres de Hubert Robert, un peintre français du XVIIIe siècle, et notamment un tableau très beau où l’on voit les ruines à venir d’une des ailes du Louvre alors en construction. Dans ce sens-là, nous suivons la ligne de Ray Bradbury, de Aldous Huxley ; une dystopie, un rêve devenant cauchemar, qui nous placerait dans cinquante ans, dans un monde où il n’y aurait plus de théâtres. Il ne s’agit pas d’une pièce documentaire autour du Théâtre national mais d’une fiction autour d’un bâtiment théâtral. La souffleuse invoque des théâtres où il y a des métiers, où les gens ont des fonctions et habitent «la maison» depuis longtemps. Mélanger l’idée du théâtre de troupe comme une grande famille avec des ruines est très romantique mais le dispositif d’un spectacle autour de la souffleuse transforme ce romantisme en quelque chose de beaucoup plus acéré.
Quel est le statut de Cristina? Est-elle la source ou le sujet du spectacle?
Il ne s’agit ni d’un documentaire ni d’une fiche biographique de Cristina. Notre fiction manipule, utilise et suggère presque une biographie mais elle n’est pas authentique. J’ai collecté des histoires auprès de tous les employés du Théâtre national. J’ai peu questionné Cristina avant les répétitions pour garder des découvertes collectives. Voir sur scène la réaction des autres à une histoire de Cristina me nourrit. Entre deux répétitions, j’ai réécrit les récits qu’elle avait faits et je testais, comme un adolescent avec ses parents, pour voir jusqu’où je pouvais aller. Ensuite, quand j’ai vu Cristina en scène souffler cette histoire pour que les comédiens la racontent, une ligne de travail s’est confirmée: une souffleuse a besoin de nous parler mais elle ne peut pas, ce n’est pas la convention. Une souffleuse utilise des comédiens. Ce dispositif a un pouvoir peut-être plus grand encore que celui qui parle explicitement des ruines, d’une fin du théâtre, etc. Ce n’est plus moi, l’auteur, qui en parle; je sers quelque chose que nous avons trouvé ensemble. Et c’est ce que je cherche à ce moment-là. Ce que je dis maintenant sur la dystopie, la fermeture des théâtres, j’en ai besoin pour rêver. Mais je peux le dire dans un entretien. Chercher, c’est autre chose. L’écriture et la mise en scène arrivent comme un événement. Ce n’est pas quelque chose à exercer sur les autres. C’est là que je me situe en tant qu’auteur et metteur en scène, politiquement mais aussi humainement. Je me méfie de mes rêves. Je ne les trouve pas très intéressants. Je me méfie moins de ma capacité à être avec d’autres et à inventer pour nous mettre ensemble. J’ai confiance en l’idée d’explorer aujourd’hui et d’écrire quelque chose demain matin pour proposer une scène et que naisse ensuite la véritable trouvaille, ensemble.
Propos recueillis par Marion Canelas (Festival d'Avignon)







