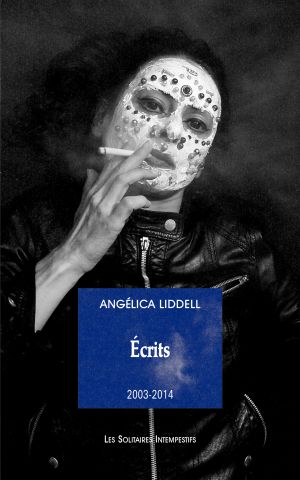
L’amour est le Mal nécessaire - Entretien avec Angélica Liddell
Entretien d'Angélica Liddell avec Christilla Vasserot à l'occasion de la présentation de Primera Carta de San Pablo a los corintios, Cantata BWV 4, Christ lag in Todesbanden. Oh, Charles ! au Théâtre de l'Odéon en novembre 2015
Christilla Vasserot : Votre dernière création - Première épître de Saint Paul aux Corinthiens - inclut, dès son titre, une référence religieuse. Les références bibliques sont par ailleurs nombreuses dans la pièce. Comment concevez-vous cette intertextualité ? Comment le discours religieux et la création s’articulent-ils ?
Angélica Liddell : Je me nourris d’une littérature et d’un art où Dieu n’a pas encore été tué, je m’intéresse au conflit avec Dieu, à la relation avec Dieu, au territoire du sacré, quand l’homme entretenait encore une relation complexe avec son esprit et que le concept de tragédie et l’énigme étaient possibles. En gros, à partir du XIXème siècle on assassine Dieu et débute une époque où l’on tente d’expliquer l’homme uniquement d’un point de vue matérialiste au travers d’une théorie économique, le marxisme, qui réduit les notions de bien et de mal, de juste et d’injuste en rapport avec le capital. Conséquence : ce qui relève du spirituel - bien plus trouble qu’une théorie économique - est anéanti. Une fois qu’on a tué le concept de Dieu, et donc l’esprit, tout ce que l’on peut raconter doit être moralement acceptable, mais la religion et l’amour sont immoraux ; la création artistique est le lieu où il est possible de se dresser contre la loi, de réaliser tout ce qui est interdit dans la vie, d’où le caractère subversif de la poésie, qui te permet de tuer des enfants de l’homme que tu aimes et d’être Médée. C'est ce qui est intéressant dans la création : l'enfer, le mal, le mariage des contraires, la liberté de pouvoir à tout moment enfreindre la loi. C’est ce qui nous fait avancer de façon irréversible vers la mort, vers le sentiment tragique de l'existence. C'est le sacré qui nous met en contact avec les convulsions spirituelles, avec l'inexplicable, avec le mystère ; le sacré est l'unique transgression possible parce qu'il va à l'encontre de tout calcul rationnel. Bataille dit que les religions sont subversives. Moi, je m'intéresse à la folie de Dieu afin de mettre l'homme en contact avec le pré-rationnel, avec les prophéties, les malédictions et les fantômes, avec le primitif, l'archaïque, qui n'est rien d'autre que l'origine de l'humanité, le premier cri sur Terre dont on dit qu'il fut la parole de Dieu. Face à Dieu et face à l'amour, nous nous posons les mêmes questions, nous utilisons le même vocabulaire. La beauté formelle de certains des livres de la Bible est superbe, pas parce que le texte articule le discours religieux et la création poétique, mais parce que la Bible appartient elle aussi à la création poétique. L'essence de la création consiste à transgresser toutes les lois que nous devons respecter dans la vie. Tel est l'espace tragique où s'unissent Dieu, l'amour et la mort. En d'autres mots, l'origine de la tragédie est la transgression de la loi. Désobéir au calcul de la raison est ce qui nous met en contact avec l'essence des émotions humaines, avec notre ÊTRE PRIMITIF, qui est l'ÊTRE qui moi m'intéresse. Cette transgression, c'est la poésie.
C. V. : Une autre référence essentielle de votre dernier spectacle est le film de Bergman, Les Communiants (Winter light). Comme l'articulez-vous avec L'Épître de Saint Paul ?
A. L. : Il y a en fait trois lettres dans le spectacle : la lettre de Marta à Tomas dans Les Communiants, la lettre de la Reine du Calvaire au Grand Amant, et L'Épître de Saint Paul aux Corinthiens. Les trois réunies forment le système nerveux d'un même corps, chacune a influencé les autres et s'est laissé influencer. Marta, à travers l'être aimé (un prêtre qui a perdu la foi) entre en contact avec Dieu, l'être aimé se transforme en une mission ; la Reine du Calvaire évolue dans cette mission jusqu'à devenir la folie de Dieu, jusqu'à diviniser l'être aimé et atteindre le paroxysme de l'extase. Dans cette lettre, j'utilise le discours que Saint Paul utilise pour exprimer sa foi, le vocabulaire de la foi et de l'amour coïncident, c'est le même discours, irrationnel, c'est la folie de Dieu, et le spectacle se termine sur le chapitre le plus célèbre de L'Épître de Saint Paul, le chapitre 13, celui où l'exaltation de l'amour prend le dessus sur la sagesse, sur les biens matériels et les dons de chacun, et qui au travers de la douleur devient une véritable Vanité. Les cheveux servent à exprimer tout cela. Marta a de l'eczéma sur la tête, la Reine du Calvaire se rase la tête à cause de cet eczéma. Saint Paul énonce des recommandations sur l'usage du voile et les cheveux des femmes, dont la tête ne peut pas entrer en contact direct avec Dieu. La Reine du Calvaire, dans sa folie, désire s'identifier avec l'être aimé au point de se raser les cheveux, et la soumission se transforme en offrande, elle veut entrer en contact avec Dieu grâce à une hérésie née au sein même du sacré. Ce rapport aux cheveux rejoint ensuite l'iconographie de Marie Madeleine, figure au sein de laquelle se rejoignent les deux thèmes principaux du spectacle : l'amour et la résurrection. Elle est la première personne devant laquelle apparaît le Christ ressuscité, ce qui déclenche un conflit présent dans les trois lettres, le noli me tangere. D'un autre côté, le fait qu'il s'agisse de lettres, établit une relation conflictuelle avec la parole : Marta écrit à Tomas parce qu'elle ne sait pas exprimer son amour autrement qu'à travers la parole écrite ; la Reine du Calvaire en vient à haïr la parole, qui lui semble insuffisante ; et enfin, pour Saint Paul, le don des langues est sans objet s'il manque le plus important, c’est-à-dire l'amour. Au fond les trois lettres donnent raison à Baudelaire : l'amour est le Mal nécessaire, qui nous fait entrer en contact pour de bon avec nos véritables émotions, en marge de tout pacte social et de la raison. Face à la violence de l'amour, l'âme humaine se révèle, la religion (le sacré) et l'amour ont pour fondements la violence spirituelle, c'est pour cela qu'ils sont subversifs et s'opposent à toutes les lois. De plus, il est arrivé quelque chose de véritablement étrange – ou normal, je ne sais pas – le jour de la première de la pièce à Lausanne : c'est presque devenu une histoire de possession, car mon corps s'est couvert d'un eczéma qui m'a causé des démangeaisons insupportables, comme si l'irrationnel avait pris forme dans ma propre chair. Plus aucune théorie ou explication du spectacle ne faisait le poids devant mon corps tuméfié, qui devenait comme un exemple ardent de l'inexprimable. De même, les colombes et les corbeaux sont devenus un exemple de l'énigme, eux avec qui j’ai parlé dès le début des répétitions, les descendants du déluge, ce fatum qui volait en dessinant des cercles au dessus de ma tête sans que je puisse rien faire pour l'éviter.
C. V. : Pendant que votre corps se couvrait de plaies, la scénographie dévoilait un autre corps, le beau corps nu de la Vénus du Titien. Quel rôle tient cette image dans le spectacle ?
A. L. : Vénus était la déesse de Corinthe du temps de Saint Paul. Elle est le revers charnel de cet amour, dont parlait Saint Paul. Mais pour moi, elle est l'image du châtiment. C’est une image d'une cruauté brutale qui rend évidente la souffrance de celui qui aime, qui rend évidente la laideur de celui qui ne peut être aimé. Le christianisme est plus proche de l'homme, de la souffrance de l'homme, de la complexité de l'esprit, mais la déesse profane, elle, ne fait que punir ; quand elle enflamme les os de Didon, elle le fait pour la tuer, pour la conduire au suicide et pour avantager Énée à la guerre. Le christianisme est fondé sur la pitié, Vénus sur la cruauté.
C. V. : L'Épître de saint Paul aux Corinthiens, You are my destiny et Tandy font partie d'une même trilogie intitulée Le Cycle des résurrections. Pouvez-vous expliquer ce titre et les liens qui unissent ces trois pièces ?
A. L. : Chaque pièce est un voyage pour atteindre la lumière à travers les ténèbres. Arrivés à la moitié de la vie, comme Dante dans la Divine Comédie, perdus dans la forêt obscure, nous entreprenons une ascension guidée par l'être aimé, cet être en qui convergent Dieu et l'amour. Dans ce chemin vers le paradis, j’ai été accompagnée par Virgile, mais aussi par Sherwood Anderson, Sergueï Paradjanov, Ingmar Bergman et Saint Paul, ainsi que par les mystiques comme Hildegarde de Bingen, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Emily Dickinson, sans compter les prophètes, notamment Ésaïe. Au fond, j'ai l'impression d'être en train de prendre congé de la vie, et c'est pour cela que j'ai besoin de me réconcilier avec le concept de Dieu, ou de batailler avec lui, comme Jacob avec l'Ange, je veux être capable de lutter avec Dieu. D'autre part les questions que je me pose vis-à-vis de Dieu sont les mêmes que celles que je me pose vis-à-vis de l'amour, d'où la divinisation de l'être aimé, et l'inévitable mysticisme qui réunit les trois pièces, donnant lieu à un de visions, d'extases, d'expériences ineffables, sans structure logique, qui accompagnent les trois offrandes.
C. V. : Pour vous qualifier et pour qualifier vos premiers spectacles montrés en France (La Maison de la force, L'Année de Richard), on a utilisé des mots tels que “la douleur”, “la rage” ou “la colère”. Était-ce une autre époque ?
A. L. : La douleur, la rage et la colère sont mes blessures, mes lésions de naissance. Elles ne sont ni un objectif, ni une intention délibérée. Simplement, dans la création, elles changent d’aspect, elles muent, elles peuvent prendre la forme de la vengeance ou du suicide. Elles peuvent mener à l'écroulement ou à l'euphorie. Par la création, j'essaie de transformer la misère en beauté, et c'est toujours un acte de violence esthétique qui a pour origine une lésion de naissance.
C. V. : Dans certains spectacles, vous étiez seule en scène. Dans d'autres vous êtes accompagnée par des acteurs, des musiciens, des acrobates, des enfants... Et dernièrement, en particulier dans L'Épître de Saint Paul aux Corinthiens, vous travaillez avec des figurants. Est-ce que votre façon de travailler diffère selon qui vous accompagne ?
A. L. : Il s'agit dans tous les cas de prolongations de mon corps. Je travaille toujours seule, même s'il y a beaucoup de monde sur scène, c'est une seule chair.
Propos recueillis et traduits par Christilla Vasserot, mai 2015







